Au IIIe siècle, le
christianisme se répand dans l’empire romain en dépit des grandes persécutions
et de l’hostilité du monde païen. Il est notamment la cible des intellectuels. Si
au début de l’ère chrétienne, il semblait bien faible pour résister à leurs
critiques, il parait désormais suffisamment fort pour s’y opposer
avec vigueur et ténacité. Sa force s’explique en partie par le développement
d’une élite chrétienne et par la faiblesse de leurs adversaires.
Cependant parmi tous les intellectuels païens, un philosophe se démarque :
Porphyre.
 |
Porphyre est « après Celse, et plus encore que Celse, le
plus redoutable adversaire que le christianisme ait rencontré durant les
premiers siècles. »[1]
Consciencieux et plus rigoureux, il engage en effet un combat redoutable contre
les chrétiens. Ses critiques portent surtout sur la Sainte Écriture. Aujourd'hui
encore, elles continuent à faire mal. Mais ses attaques ne sont pas restées
sans réponse. L’Église a disposé suffisamment de combattants à la hauteur des
enjeux pour relever le défi.
Notre article s'appuie sur un ouvrage fort intéressant, intitulé La réaction païenne, étude sur la
polémique antichrétienne du Ier au IVe siècle de Pierre de Labriolle
(1874-1940). En dépit de son ancienneté, il garde tout sa pertinence. Nous
avons aussi pris en compte des articles récents qui le complètent et le corrigent.
Né vers 232-233 dans
la région de Tyr, actuellement en Palestine, Porphyre est un sémite hellénisé.
Il s’est formé à Athènes sous la direction de Longin (213-273) puis à Rome où il est
devenu disciple de Plotin, le fondateur du néoplatonisme. Il est l’auteur d’une
biographie de Plotin et des Ennéades, une reprise des cours de
son maître.
Porphyre s’est très
tôt intéressé au christianisme. Ses critiques montrent en effet qu’il a une
connaissance bien approfondie de la doctrine chrétienne. Autrefois, on croyait
qu’il avait été catéchumène, voire chrétien. Cette thèse est aujourd'hui
abandonnée.
Avant de connaître
Plotin, Porphyre s’était attaqué aux chrétiens dans deux ouvrages : Philosophie
des Oracles et Images des Dieux.
Le premier ouvrage
a pour but de développer « une
doctrine philosophique » en vue d’obtenir le salut de l’âme. « Il est solide et inébranlable celui
qui puise en cet ouvrage ses espérances d’obtenir le salut, comme en l’unique
source sûre. » [3] Les
oracles sont considérés comme une révélation des dieux. Selon Saint Augustin,
cet ouvrage est insultant et méprisant à l’égard des chrétiens, jugés impies et
souillés, entêtés dans leurs préjugés et la démence. Aujourd’hui encore, il est
vu comme « un traité dirigé
expressément contre les chrétiens »[4].
Comme le premier ouvrage, le second est un ramassis de superstitions et
d’absurdités. Porphyre adhère facilement à toutes sortes de doctrines
malheureuses. Ces critiques semblent viser les chrétiens, « gens complètement ignorants qui, aussi
stupides devant une statue qu’un illettré devant l’inscription d’une stèle »[5].
Formé au combat intellectuel
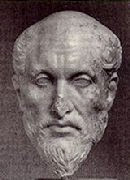 |
| Plotin (205-270) |
Par Longin, Porphyre
est formé à la méthode critique. Longin est en effet reconnu à son époque comme
un redoutable philologue qui excelle dans la critique. Il lui transmet le goût
du savoir positif, des comparaisons de textes, des discussions chronologiques.
Porphyre se forme ainsi à la controverse et excelle à son tour dans la critique.
Son véritable
maître, Plotin, va « élargir les
perspectives de sa pensée et lui ouvrir le monde infini des problèmes de la
métaphysique et de la vie intérieure. »[6]
Ils partagent la même ambition : revigorer et revivifier la culture
antique. Ils veulent aussi rehausser le prestige des cultes païens. Pour défendre la
culture antique, Porphyre attaque naturellement son principal adversaire, le
christianisme. Pour cela, il étudie la Sainte Bible et les méthodes d’exégèse
en usage à son époque…
Le traité Contre les Chrétiens
Porphyre écrit en
effet « l’œuvre le plus étendue et
la plus savante qui ait été composée durant l’antiquité contre le christianisme »[7].
C’est par cet ouvrage qu’il gagne son titre d’« ennemi de la véritable piété »[8].
Cet
ouvrage est effectivement « une
violente attaque, une critique impitoyable portées contre le cœur même de la
nouvelle religion chrétienne »[9]. L’autorité impériale aurait cherché à le détruire, ce qui expliquerait que nous n’en disposions que des
fragments. Il a été en
circulation au moins jusqu'au Ve siècle. Nous en connaissons des fragments
grâces à des auteurs chrétiens (Saint Jérôme, Eusèbe de Césarée, Saint
Augustin, etc.).
Si le livre a été
perdu, il n’a pas été oublié. Certains auteurs du Moyen-âge le mentionnent
encore. Il réapparaît surtout à partir du XVIIe siècle. Certains érudits
tentent de le reconstituer à partir des fragments disséminés dans les livres
chrétiens. De nouvelles découvertes au XIXe siècle et les travaux qui ont suivi
donnent l’occasion à Harnack de publier des fragments en 1916. La
collection qu’il propose devient l’ouvrage de référence jusque dans les années
70. Mais la présentation de Harnack apparaît de nos jours artificielle et arbitraire [10].
Certaines objections antichrétiennes ont été faussement attribuées à Porphyre. Certaines
d’entre elles proviendraient du IVe siècle. Les fragments dateraient donc de
270 à 380 environ.
Selon une thèse récente [11], ce livre n’aurait peut-être pas existé. Il constituerait en fait une partie de la Philosophie des Oracles. Mais cette thèse est aujourd'hui contestée …
L’étude actuelle de
ces fragments révèle un double constat. D'une part, la victoire du
christianisme n’a pas fait taire les intellectuels païens. Rappelons que l’édit
de Constantin qui donne la liberté religieuse aux chrétiens date de 313. Les
intellectuels païens n’ont donc pas abandonné la lutte. L’arrivée de Julien
l’Apostat sur le trône impérial en 361 est encore la manifestation d’un
paganisme virulent. D'autre part, les adversaires du christianisme se sont
appropriés de la doctrine et de la terminologie chrétiennes. Ils peuvent donc
être très redoutables.
Par simplicité, nous allons désormais considérer les objections antichrétiennes de la collection d’Harnack au travers de l’ouvrage de Labriolle. Sous le nom unique de Porphyre, nous considérons l’auteur de l’objection considérée sans attribuer la paternité à Porphyre.
Intéressons-nous
davantage aux violentes accusations antichrétiennes que développent Porphyre.
Elles reprennent en partie les objections les plus classiques auxquelles ont déjà
été confrontés les chrétiens. Il faut toutefois noter l’absence des lieux
communs des polémistes païens des premiers siècles. Nous avons affaire en général à des objections beaucoup plus sérieuses. Enfin, autre constatation
d’importance, aucune critique n’est faite contre les dissensions des
communautés chrétiennes contrairement à Celse qui soulignait la division des
chrétiens en de multiples sectes. Ces objections tentent en fait de lutter
contre le christianisme en lui-même. Porphyre s’attaque au cœur de sa doctrine.
Contre les Apôtres et les
Évangélistes
Dans le traité Contre
les Chrétiens, Porphyre engage un véritable combat contre le
christianisme. La Sainte Bible est la cible de ses critiques les plus acerbes.
« Les évangélistes sont les
inventeurs, non les historiens des choses qu’ils racontent de Jésus »[12].
En employant un regard critique minutieux sur le Nouveau Testament, il y relève
des discordances et des contradictions : généalogies du Christ
différentes, invraisemblance de certains détails, exagération tendancieuse,
etc. Nous pouvons déjà constater qu’il distingue le Christ de l’histoire dont
il reconnaît l’existence et le Christ des Apôtres qu’il juge pure invention. La
critique du XXe siècle reprendra cette distinction en la présentant comme une nouveauté…
Porphyre attaque de
manière virulente les Apôtres et plus spécialement Saint Pierre et Saint Paul qui se seraient laissés abuser par les prodiges de Notre Seigneur. Il souligne
la disproportion entre le rôle qu’ils tiennent dans le christianisme et leur
personnalité faible, sans envergure, chétive. Il met aussi en exergue les
contradictions de Saint Paul qu'il présente comme le reflet de sa duplicité. Subtil, il souligne
le désaccord entre les deux apôtres pour montrer la fiction des dogmes qu’ils
prêchent.
Il relève également
toutes les maladresses des évangélistes pour souligner l’inconvenance du caractère
inspiré de leur livre. Il remarque que certaines citations de l’Ancien
Testament ne sont pas en effet attribuées à leur véritable auteur.
Contre une certaine lecture de
la Sainte Écriture
 |
| Origène (185-254) |
Il refuse les
méthodes exégétiques en usage chez les chrétiens. Il tente en effet de
disqualifier le procédé de la lecture allégorique très employée notamment à
Alexandrie. « Certaines gens,
remplis du désir de trouver le moyen, non pas de rompre tout à fait avec la
pauvreté des écritures judaïques, mais de s’en affranchir, recourent à des
commentaires qui sont incohérents et sans rapport avec les textes et qui
apportent, non pas une explication satisfaisante pour les étrangers, mais de
l’admiration et de la louange pour les gens de la maison. »[13]
Il dénonce alors l’abus de cette méthode qui fascine et trompe. Origène fait
alors l’objet de ses critiques. « Cette sorte d’absurdité vient d’un homme que
j’ai, moi-aussi, rencontré dans ma première jeunesse, Origène… » [14]
Porphyre considère que certains textes parfaitement clairs, comme la
description des rites, n’ont pas besoin d’une interprétation allégorique.
Contre l’infidélité des
chrétiens
Porphyre défend l’autorité
de la religion juive, liée à son antiquité et à son caractère national, pour
mieux montrer l’infidélité du christianisme. Il dénonce les chrétiens comme des
traîtres, des renégats. Il loue aussi les Hébreux pour mieux souligner le fait
que les chrétiens ont corrompu le judaïsme. Il juge en outre illégitime l’usage
chrétien de la Sainte Écriture.
Porphyre s’oppose à l’attitude
du Christ. Elle lui paraît « étrange,
inconcevable et tout à fait contradictoire à l’idée qu’on peut se former d’une
âme divine, ou même d’une âme héroïque. »[15]
Le récit de la Passion est l’exemple même de cette image qui le répugne. Il
s’indigne en effet contre tout ce qui s’oppose à l’image des héros grecs. Tout
cela ne mérite que mépris. « Même
s’il devait souffrir par ordre de Dieu, il aurait dû accepter le châtiment,
mais ne pas endurer sa Passion sans quelques discours hardis, quelques paroles
vigoureuses et sages, à l’adresse de Pilate, son juge, au lieu de se laisser
insulter comme le premier venu de la canaille des carrefours. »[16]
Porphyre a déjà
critiqué ce point dans son premier ouvrage. Dans un oracle supposé d’Apollon, il
laisse échapper son mépris envers les chrétiens qui, obstinés, adorent un
« Dieu mort, condamné par
d’équitables juges, et livré publiquement au plus ignominieux des supplices. »[17]
Il s’indigne aussi contre la Résurrection qui manque terriblement de panache. Tout
cela s’oppose à l’image qu’il s’est faite de Dieu, une image plus proche de
celle du Dieu des Hébreux.
Porphyre en vient à
préférer les juifs aux chrétiens puisqu'il les considère comme les vrais
adorateurs de Dieu. Effectivement, il proclame la grandeur du Dieu des juifs,
toujours selon un oracle d’Apollon : « C’est le Dieu, générateur et roi avant toute chose, Dieu devant lequel
tremblent le ciel et la terre, la mer et les secrets abîmes de l’enfer ;
devant lui les divinités mêmes frémissent d’épouvante. Père souverain, les
saints Hébreux, dont il est la loi, l’honorent religieusement. » [18]
Contre la doctrine et la morale chrétienne
Les dogmes font également
l’objet de critiques. Le dogme de la Résurrection est le plus attaqué. Il
s’oppose à cette idée qu’un corps en déliquescence puisse ressusciter. L’idée
même de la fin de l’Univers lui est inconcevable. Cela va à l’encontre de la
perfection divine dont la manifestation est la permanence, la régularité, l'ordre.
Comme Celse,
Porphyre trouve insupportable la morale chrétienne. Dieu serait-il venu pour
s’occuper uniquement des malades et des faibles ? La complaisance envers
les pauvres l’offense. Ce ne serait pas la vertu qui ouvre les portes du ciel
mais le manque d’argent.
Les rites chrétiens
ne sont pas épargnés. Comment une simple ablution pourrait-elle effacer les
fautes ? Il juge le baptême immoral. Il est surtout indigné par le
sacrement eucharistique qui le présente comme un acte de cannibalisme. Il prend
en effet à la lettre les paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ qu’il a
prononcées lors de la Cène.
En un mot,
contrairement à ses prédécesseurs, Porphyre semble connaître ce qu’il critique et appuie
ses attaques avec des exemples précis. Il est vrai aussi qu’il adhère à
certaines critiques qui montrent encore une profonde ignorance ou de la
mauvaise foi facilement rejetable. Il a lu et étudié les Saintes Écritures. Il
a aussi étudié la doctrine chrétienne. Le christianisme trouve donc en ce
philosophe un adversaire plus sérieux qui soulève parfois de véritables
difficultés. Certaines de ses critiques ont traversé les siècles et parfois,
ils resurgissent encore pour nous mettre en difficulté. Rares sont les
nouvelles remises en cause. Tout a été presque dit dès le IVe siècle.
Une critique encore plus
terrible
Certains
commentateurs estiment que Porphyre n’attaquerait pas le Christ. Au contraire,
il l’estimerait. Il s’opposerait en fait à l’image du Christ tel qu’elle
apparaît à la lecture des Évangiles. « Sa
philosophie lui fait éprouver pour la personne même du Christ et pour certaines
parties de son enseignement plus que de la sympathie, presque du respect. C’est
au disciple de Jésus, c’est aux déformations dont ils sont les premiers
auteurs, c’est aux mythes des Évangiles qu’il en veut »[19].
Ainsi à leur tour, des commentateurs distinguent le Christ de l’histoire et le Christ de
l’Évangile.
Pierre de Labriolle réfute catégoriquement cette thèse. « On ne voit pas bien ce Jésus porphyrien, qui obtiendrait les respects du philosophe, tandis que le Jésus évangélique n’aurait mérité que ses dédains ? »[21] Cette thèse s’appuie sur une seule critique de Porphyre qui accuserait les évangélistes d’être des menteurs ou des affabulateurs et respecterait au contraire le Christ. Or tout cela est calculé. Ce n’est que pure ironie de la part d’un maître de la polémique.
Saint Augustin estime
aussi que Porphyre dit du bien du Christ et du mal aux chrétiens : « les dieux ont déclaré que le Christ était un
homme pieux, et qu’il est devenu immortel ; ils lui gardent le souvenir le
plus flatteur. Quant aux chrétiens, dit-il, le témoignage des dieux les déclare
souillés, infâmes, enlacés dans les filets de l’erreur. »[20]
Dans un autre oracle, Porphyre ajoute : « ceux qui l’honorent se sont aliénés la vérité. »
Dans son commentaire de Philosophie des Oracles,
Saint Augustin a aussi décelé la tactique de Porphyre : louer le Christ
pour mieux dénoncer les chrétiens. Son ennemi n’est pas le Christ qu’il veut
absorber dans le panthéon mais le christianisme et ses disciples. Les insultes que
Porphyre prononce contre les Apôtres n’ont en effet pour but que de rabaisser
leur maître. « Si Jésus fut tel que
le montrent les Évangiles, Porphyre le vilipende sans merci. Mais comment se
formerait-il de Jésus une image tout autre que celle que les Évangiles lui
proposent ? » [22] Il sait très bien qu’en attaquant la Sainte Écriture et
les disciples de Notre Seigneur, il atteint le christianisme.
Une lutte décisive
Ainsi « obscurité, incohérence, mensonge, abus de
confiance et sottise, Porphyre n’a guère vu autre chose dans le christianisme »[23].
Porphyre est plein de mépris, de moquerie et de sarcasme à l’égard du
christianisme. « Fi ! Quelle
grossièreté ! Quelle erreur comique ! »[24]...
« Ces histoires puériles, bonnes
pour des enfants en bas âge et des femmelettes, on a quelque peine à les
entendre sans colère. »[25]...
« Les animaux eux-mêmes
protesteraient en leur langage s’ils pouvaient comprendre. » [26]...
Les chrétiens ne seraient que des ignorants, faibles et sans esprit. Nous
sommes toujours en présence d’un esprit hellénique hautain et sûr de lui-même.
Tout cela dénote un
certain état d’esprit. Porphyre ne cherche pas finalement à comprendre la
pensée chrétienne. Il se jette dans la bataille de toutes ses forces. Tout est
bon pour attaquer et avilir les chrétiens. Il n’évite pas la niaiserie, la
stupidité, la mauvaise foi. Aucun effort n’est tenté pour
comprendre le sens caché de certaines paraboles pourtant évidente. Toute la Sainte
Bible est passée au crible afin d’en extraire tout ce qui est utile pour
nourrir sa critique. « Il semble que
le paganisme lui-même se plaigne, dans sa langue, que l’Évangile lui a enlevé
le monde par surprise. Le ressentiment de la vieille société perce dans
ces accusations. »[27]
La contre-attaque chrétienne
Les chrétiens ne se
sont pas trompés sur la nocivité des critiques porphyriennes. Les défenseurs de
la foi et les empereurs ont considéré Porphyre comme « l’ennemi le plus acharné du christianisme »[28].
Il en est même devenu le symbole infamant. Ainsi certains hérétiques comme les
ariens et les nestoriens ont été traités de porphyriens.
Le traité Contre
les Chrétiens a fait l’objet de nombreuses réfutations de la part des
chrétiens, notamment de la part de Méthode d’Olympe, d'Eusèbe de Césarée et
d’Apollinaire de Laodicée [29].
De ces réfutations, nous ne disposons plus aujourd'hui que de petits fragments.
La réponse la plus complète est celle d’Eusèbe de Césarée dans le traité Contre
Porphyre. Néanmoins, s’il est mentionné à plusieurs reprises par des
auteurs chrétiens, son existence semble faire aujourd'hui l’objet de discussions.
Les contradictions de Porphyre
Les critiques de
Porphyre nous étonnent. Comment peuvent-elles se contredire plusieurs
fois ? Il reconnaît le Dieu des Hébreux, un Dieu terrible qui fait frémir
toutes les divinités mais comme le souligne Saint Augustin, il n’a pas peur de
ne pas l’honorer comme il se doit.
Mais ce qu’il
honore, ce n’est point Dieu, c’est la représentation de Dieu telle qu’il s’est formé.
C’est pourquoi il s’indigne contre l’enseignement des chrétiens. Il ne peut
comprendre que le Christ puisse endurer la souffrance de la Croix. Car pour
lui, la divinité se manifeste par la force et la quiétude, par l’ordre et la
paix. Il ne peut non plus comprendre que le « bas-peuple » puisse adorer en vérité Dieu. Porphyre ne peut
admettre qu’un Christ parmi la compagnie des dieux comme un héros antique
immortalisé. Ainsi loue-t-il cette image du Christ tout en méprisant le Christ
qu’adorent les chrétiens. Il condamne finalement le christianisme pour protéger
la culture antique. Il perçoit probablement l’incompatibilité entre le monde
chrétien et le monde antique.
Saint Augustin
voit aussi une contradiction dans les oracles. Les uns louent la piété du
Christ quand d’autres louent les accusations qu’on porte contre lui. Comme nous
l’avons déjà évoqué, certains commentateurs résolvent cette contradiction en
opposant le Christ de l’histoire et le Christ des Évangiles. Or Saint Augustin
est plus perspicace. « En louant le
Christ, Porphyre […] prétend qu’il est
pour les chrétiens une fatalité d’erreur ». En effet, un oracle
d’Hécate nous apprend : « l’âme
des justes réside en paix aux célestes erreurs. Or, pour les âmes à qui les
destins n’ont pas permis d‘obtenir les faveurs des dieux ni la connaissance de
Jupiter immortel, l’âme de cet homme a été comme une fatalité d’erreur. Elles
sont détestées des dieux, … »[30]
Il pose alors la légitime question : est-ce intentionnel ou
involontaire ? S’il a voulu être une « fatalité d’erreur », comment est-il juste ? S’il ne l’a
pas voulu, comment est-il heureux ? Dans les deux cas, il ne peut être
Dieu.
Prenons un autre
exemple plus flagrant de ses contradictions. Porphyre recherche à défendre et à
revivifier les mythes antiques notamment en les spiritualisant. Pour cela, il
utilise l’allégorie dans ses ouvrages. Il défend même son usage. « On ne doit pas croire que de telles
interprétations soient forcées et en voir en elles qu’hypothèses d’esprits
subtils »[31].
Or il refuse aux chrétiens le même emploi de l’allégorie. « Il ne veut pas qu’ils éludent les passages
difficiles et compromettants, qu’il entend bien exploiter contre eux. »[32]
Finalement, Porphyre
attaque Notre Seigneur tel qu’il se le représente à partir des Évangiles car
cette représentation ne correspond pas à l'image de Dieu qu'a développée la culture grecque. Le
Christ porphyrien n’a rien de commun avec le véritable Christ. Il l’imagine sans
s’appuyer sur des faits. De quel droit ?
En outre, la moindre difficulté
est source de critique et non d’interrogations. Il ne cherche pas en effet à
résoudre les difficultés qu’il perçoit. Il ne recherche que des prétextes pour
rabaisser le christianisme. Certes il semble ménager Notre Seigneur tel qu’il se
le représente mais ce n’est que pure tactique. Il ne cherche pas à comprendre.
Il accuse, il méprise…
Enfin, de manière
paradoxale, Porphyre nous aide à mieux comprendre le mystère profondément divin
du christianisme. Il nous décrit les Apôtres comme des faibles qui ne savent
pas manier l’art du discours pour enseigner et pourtant ils ont convaincu
l’empire romain. Il présente l’enseignement du christianisme comme étant
vulgaire, absurde, avilissant et pourtant, il a conquis l’élite intellectuelle.
Il s’oppose à cette religion si contraire à la culture antique et cette
dernière a été vaincue. En dépit de ses apparentes contradictions, la foi a conquis des cœurs et des intelligences. Les faiblesses du
christianisme qu’il souligne tant révèlent d’autant mieux le mystère de sa victoire. Étrange
contradiction qui explique tant de rancœurs et de mépris chez un homme bien
impuissant…
Drôle de destin
que celui de Porphyre. Il a voulu revivifier la religion antique et épurer le
culte traditionnel mais les païens ne l’ont pas accepté, ne voyant dans ses
manœuvres qu’un sacrilège. Pire encore. Les chrétiens ont utilisé certains de ses
arguments pour remettre en cause leur idolâtrie. La Philosophie des Oracles a
été pour les Pères de l’Église un bel instrument apologétique…
Porphyre a voulu
combattre le christianisme pour sauver la culture antique. Tout en l’accablant
de critiques, il a cherché à spiritualiser le culte païen. Cet effort de
spiritualité et d’intériorité sera encore plus marquant chez ses successeurs qui
voudront aussi défendre leur monde. Ils essayeront même d’institutionnaliser et
de restructurer la religion antique à la manière du christianisme. Ce sera un
échec. L’évolution n’est pas la voie naturelle du succès...
[1] Pierre de Labriolle, La réaction païenne, étude sur la
polémique antichrétienne du Ier au IVe siècle, Cerf, 2005.
[2] Saint Augustin, La Cité de Dieu, XIX, XXIII, trad.
par L. Moreau, revu par JC Eslin, éditions du Seuil, 1994.
[3] Philosophie des oracles, fragment 303 cité dans Hypothèses
récentes sur le traité de Porphyre Contre
les chrétiens de Richard Goulet, 24 mars 2008, CNRS, Villejuif, publié dans Hellénisme et christianisme,
Michel Narcy et Eric Rebillard (Ed.) 2004.
[4]
Richard Goulet, Hypothèses
récentes sur le traité de Porphyre Contre
les chrétiens.
[5] Porphyre, Images des Dieux, trad. par J.
Banez.
[6] Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[7] Harnack (1851-1930), théologien protestant. Il est l'historien de l'Eglise le plus important du XIX et début XXe siècle.
[8] Concile de Nicée.
[9] Pier Franco Beatrice, Le traité de Porphyre contre les
Chrétiens, L'état de la question, Kernos, Centre International d’Étude
de la religion grecque antique, 1991, mis en ligne le 11 mars 2011, consulté le
16 octobre 2012, http://kernos.revues.org.
[10] Une grande partie des fragments provient de l’Apokritikos
de Macaire, évêque de Magnésie. Ce dernier réfute un païen qu’Harnack a
identifié à Porphyre. Aujourd’hui, son hypothèse s’avère fausse. C’est un
auteur anonyme du IVe siècle.
[11] Thèse développée par P.F. Beatrice dans de nombreux
ouvrages, thèses reprises par d’autres historiens. Voir Hypothèses récentes sur le traité de Porphyre Contre les chrétiens de Richard
Goulet, CNRS, Villejuif.
[12] Porphyre, fragment
n°15, cité dans La réaction païenne de Pierre de Labriolle.
[13] Porphyre retranscrit par Eusèbe de Césarée dans Histoire
ecclésiastique, chapitre XIX, trad. Grapin, collection Hemmer-Lejay,
cité dans La réaction païenne de Pierre de Labriolle.
[14] Porphyre retranscrit par Eusèbe de Césarée dans Histoire
ecclésiastique, chapitre XIX, cité dans La réaction païenne de
Pierre de Labriolle.
[15] Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[16] Porphyre, Fragment n°63 cité dans Pierre de
Labriolle, La réaction païenne.
[17] Porphyre, Philosophie des Oracles, III, cité
dans La
Cité de Dieu de Saint Augustin, Livre XIX, XXIII, trad. Louis Moreau revue par JC Eslin, éditions du Seuil, 1994.
[18] Porphyre, Philosophie des Oracles, III, cité
dans La
Cité de Dieu de Saint Augustin, Livre XIX, XXIII.
[19] M. Bidez cité dans Pierre de Labriolle, La
réaction païenne.
[20] Porphyre cité dans dans La Cité de Dieu de Saint
Augustin, Livre XIX, XXIII.
[21] Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[22] Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[23] Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[24] Porphyre, Fragment n°4.
[25] Porphyre, Fragment n°54.
[26] Porphyre, Fragment n°35.
[27] Edgar Quinet, Revue des deux Mondes, 1er
décembre 1838 cité dans Pierre de Labriolle, La réaction païenne.
[28] Sait Augustin, La Cité de Dieu, Livres XIX, XXII.
[29] Voir Saint Jérôme, Lettre LXX. Saint Jérôme
juge qu’Eusèbe de Césarée, Méthode et Apollinaire ont bien répondu aux
critiques de Porphyre. Philostorge a le même jugement, soulignant l’excellence
de l’ouvrage d’Apollinaire.
[30] Porphyre, La
philosophie des Oracles, cité dans La Cité de Dieu de Saint Augustin,
Livre XIX, XXIII.
[31] Porphyre, Antre
des Nymphes, §36, trad. Trabucco.
[32] Pierre de Labriolle, La
réaction païenne.










