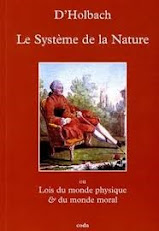Dans
Candide,
Voltaire pose le problème du mal sans pourtant apporter de réponses[3]. Il
critique en fait la doctrine de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) à travers le personnage grotesque de Pangloss,
qui ne cesse de la professer par son fameux slogan « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », formule
simple qui désigne en fait la thèse beaucoup plus complexe de Leibniz.
Essais
sur la théodicée
En
1710, Leibniz fait paraître un ouvrage intitulé Essais de Théodicée sur la bonté
de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal. Il répond à ceux
qui, ne pouvant résoudre le problème du mal, refuse à la raison d’y trouver une réponse et qui propose alors de se
laisser guider par le destin, ce qui leur permet de justifier leur conduite
morale et leur libertinage. Notre attitude à l’égard de ce problème n’est
pas en effet sans conséquence sur notre piété et sur notre salut. Si tout est
écrit, autant profiter de la vie et de ses plaisirs ! Leibniz répond aussi
aux philosophes et théologiens qui, pour répondre à cette philosophie favorable
au destin, n’hésitent pas à nier un des attributs de Dieu pour en sauver
d’autres au point de défendre un Dieu impuissant ou tyrannique.
Dans
ses Essais
sur la théodicée, Leibniz cherche à lever les difficultés que soulève
le problème du mal en traitant de la nécessité et de la liberté puis à défendre
la justice et la bonté de Dieu. « Quant
à l’origine du mal, par rapport à Dieu, on fait une apologie de ses
perfections, qui ne relève pas moins sa sainteté, sa justice et sa bonté,
que sa grandeur, sa puissance et son indépendance. »[4] Il justifie que Dieu permet le mal sans que
cela ne porte préjudice à sa sainteté et sa bonté suprêmes. Finalement, dans
son ouvrage, « c’est la cause de
Dieu qu’on plaide. » Le terme de « théodicée », qu’il a lui-même créé à partir de deux termes
grecs, signifiant « dieu »
et « la manière d’agir » ou
« justice », désigne une
justification de la bonté de Dieu en dépit de la réalité du mal. Leibniz monte aussi
indirectement que la raison est capable
d’apporter une réponse au problème du mal.
Le
problème du mal, une question insoluble pour la raison ?
Leibniz
répond plus particulièrement aux écrits de Pierre
Bayle (1647-1706) qui traitent de la liberté humaine et de la
responsabilité de Dieu pour le mal inscrit dans son œuvre.
La
position de Bayle conduit alors à rompre
le lien entre la foi et la raison, ce que ne peut accepter Leibniz. « Si les mystères étaient inconciliables avec
la raison, et s’il y avait des objections insolubles, bien loin de trouver le
mystère incompréhensible, nous en comprendrons la fausseté. »[10] Il
répond alors à Bayle que si la raison ne peut expliquer un mystère, elle ne s’y
oppose pas et ne lui adresse pas des objections insolubles. Les Essais
sur la théodicée commence donc naturellement par un discours sur la
conformité de la foi avec la raison.
Les
objections
La
première porte sur la prescience de Dieu.
Celle-ci « rend tout l’avenir
certain et déterminé ». Dieu ne peut être indifférent aux événements
qui touchent l’homme. Et comme rien ne peut exister sans qu’Il le veuille, Il
concourt nécessairement aux choses qui arrivent. Enfin, tout est ordonné, tout
effet ayant une cause, rien ne saurait arriver sans qu’il y ait nécessité. Par
conséquent, si l’homme agit, il ne peut être tenu responsable de son action.
« Il n’en mérite ni récompense ni
châtiment : ce qui détruit la moralité des actions, et choque toute la
justice divine et humaine. »[11]
Sans liberté, il ne peut donc y avoir de
responsabilité. Or « Dieu agit très librement et qu’Il ne fait
rien sans une parfaite connaissance de la chose et des suites qu’elle peut
avoir. »[12] Puisque
la réalité est « une production de
Dieu, puisque toutes les créatures et toutes leurs actions tiennent de lui ce
qu’elles ont de réel »[13], Dieu
est la cause physique et moral du péché. Ou bien Dieu fait tout indifféremment,
le bien et le mal. Il serait alors légitime de Lui imputer la faute soit parce qu’Il en est la cause, soit parce
qu’Il ne l’a pas empêchée.
La
vraie notion de Dieu
Toutes
ces objections reposent sur une mauvaise
image qui est faite de Dieu. Il veut en effet « éloigner les hommes des fausses idées qui leur représentent Dieu comme
un prince absolu, usant d’un pouvoir despotique, peu propre à être aimé et peu
digne d’être aimé. »[14]
Leibniz
commence par démontrer l’existence de
Dieu, « la première raison des choses », qui porte la raison
de son existence, et laquelle par conséquent est nécessaire et éternelle. Il en vient aussi à qualifier cette
première cause comme intelligente puisqu’elle détermine un monde parmi tous les
mondes possibles. Pour cela, elle doit avoir en avoir les idées, ce qui n’est
possible que par l’entendement ou la sagesse. Or « en déterminer une ne peut être autre chose que l’acte de la volonté qui
choisit. »[15] Et
cette volonté est efficace. Or elle ne peut l’être que s’il y a puissance.
« Et cette cause intelligente doit
être infinie de toutes les manières, et absolument parfaite en puissance, en
sagesse et en bonté, puisqu’elle va à tout ce qui est possible. »[16] Ces
trois attributs, puissance, sagesse et
bonté, qui vont respectivement à l’être, au vrai et à la volonté, sont nécessairement liés entre eux.
Le
principe du meilleur des mondes
Par
sa sagesse et sa bonté, toutes infinies, Dieu
ne peut choisir que le meilleur. S’il y avait moyen de mieux faire, il y aurait
quelque chose à corriger dans les actions de Dieu. En outre, s’il n’y avait pas
le monde meilleur parmi les mondes possibles, Dieu n’en aurait produit aucun.
Il ne nous est pas possible de savoir s’il est le meilleur puisqu’il faudrait regarder
le monde dans son ensemble, dans toutes les choses, qui sont liées
nécessairement, aussi bien dans l’espace que dans le temps, ce que nous sommes
bien incapables de faire.
Il
est certes possible de penser à un monde sans mal ni péché mais ce monde serait
inférieur au nôtre « puisque Dieu a
choisi ce monde tel qu’il est. »[17] Il est
impossible de le montrer puisque nous ne pouvons pas comparer une infinité de
mondes possibles. De même, nous pourrions croire que les maux sont bien
supérieurs aux biens mais « ce n’est
que le défaut d’attention qui diminue nos biens. »[18] Le
bien, nous le sentons qu’en raison du mal. La santé devient à nos yeux un bien
quand finalement nous devenons malades.
La
cause du mal
Leibniz
distingue trois types de maux : le
mal métaphysique, qui consiste dans l’imperfection des choses, le mal physique dans la souffrance et le mal moral dans le péché. Seul le
premier est nécessaire puisque toute chose ici est nécessairement limitée. Les
deux autres maux ne sont pas nécessaires mais restent possibles. Ils entrent
donc dans toutes les mondes possibles, y compris dans le meilleur des mondes.
La question est alors de savoir si Dieu veut le mal.
Pour
répondre à cette question, Leibniz revient sur la notion de « volonté ».
« La volonté consiste dans
l’inclinaison à faire quelque chose à proportion du bien qu’elle renferme. »[19] Elle
est dite antécédente quand elle
regarde chaque bien en tant que bien. Elle veut le bien en lui-même ou
repousser le mal. Elle est dite conséquente
quand elle produit son effet. La volonté conséquente résulte alors de la somme
des volontés antécédentes. Il s’ensuit que « Dieu veut antécédemment le bien, et conséquemment le meilleur »[20] comme
Il ne veut point le mal moral. Quant au mal physique, Il ne le veut pas d’une
manière absolue puisque Dieu peut le vouloir comme un moyen propre à une fin,
par exemple pour réaliser un plus grand bien ou empêcher un plus grand mal,
pour l’amendement ou l’exemple ou encore comme peine due au péché. Pour le mal
moral, il ne s’agit pas d’interroger le mal en tant que moyen. Il est admis et
permis s’il est la suite d’actions indispensables « de sorte que celui qui ne voudrait point permettre le péché d’autrui,
manquerait lui-même à ce qu’il doit »[21]. Cela
ne signifie pas que le mal est légitime pour faire du bien, ce que la morale
défend. Le mal moral est nécessaire quand dans tous les champs possibles, il
apparaît comme la solution la meilleure. « Et c’est dans ce sens que Dieu permet le péché ; car il manquerait
à ce qu’il se doit, à ce qu’il doit à sa sagesse, à sa bonté, à sa perfection,
s’il ne suivait pas le grand résultat de toutes ses tendances au bien, et s’il
ne choisissait pas ce qui est absolument le meilleur »[22]. Le mal est finalement l’effet de la volonté
divine de créer et de maintenir un monde meilleur parmi les mondes possibles.
Pourtant,
Dieu concourt à l’action que mène l’homme donc au péché. Cependant, par une
comparaison simple et compréhensible, Leibniz distingue la part de
responsabilité de chacun. Il considère des navires de tonnage différents qui
descendent sur une rivière selon des vitesses différentes. Si le courant permet
à chacun de descendre, leur vitesse est dû aux spécificités du bateau. C’est ainsi
que certains arrivent à bon port dans les délais contrairement à d’autres, les
plus lourds. « Dieu est aussi peu la
cause du péché, que le courant de la rivière est la cause du retardement du
bateau. »
Dieu
donne toujours à la créature ce qui lui est bon selon la mesure de ses nécessaires
limites qu’elle a reçues à sa création puisqu’elle ne peut être parfaite sinon
elle serait Dieu. La communication d’un
bien est donc limitée à sa capacité de réception tant dans l’être que dans
l’action. La privation, qui est le sens du mal, vient de la créature et non
de Dieu.
Leibniz
distingue encore la volonté productive
– Dieu veut ce qu’Il fait- et la volonté permissive
– Dieu permet la possibilité de. Dieu ne veut pas le péché (volonté productive)
mais permet à l’homme d’être libre (volonté permissive) et par conséquent de
pécher. Ce n’est pas l’objet de la permission que Dieu permet mais la
permission elle-même. Le responsable du péché reste l’homme.
Conclusions
Cependant,
si le raisonnement de Leibniz est séduisant, il ne nous satisfait pas. Leibniz
définit les attributs de Dieu à partir de l’idée qui puisse exister d’autres
mondes que le nôtre. Mais concevoir qu’il puisse avoir d’autres mondes
possibles, c’est déjà supposer un choix et donc une intelligence, une sagesse,
une puissance dans Celui qui a créé le monde. En outre, un autre monde est-il
possible ? Mais la question est vaine puisque si Dieu est intelligence,
bonté et puissance, notre monde ne peut être différent. Le principe du meilleur des mondes possibles n’a donc pas de sens.
En outre, si d’autres mondes étaient possibles, en quoi est-il meilleur ?
Parce qu’il répond à la volonté de Dieu et que Dieu ne peut vouloir que le
bien ? Or il suffit pour Dieu de vouloir pour que sa volonté se fasse. La
distinction de différentes volontés n’a pas de sens puisqu’Il est un. C’est un
artifice qui permet à Leibniz de raisonner. Nous revenons donc à l’idée même de
Dieu que semble contester la réalité du mal. Par conséquent, le principe du meilleur des mondes
possibles ne répond finalement pas à la question du mal.
Puis
le mal qui nous touche n’en est finalement pas un puisqu’il correspond à la
situation la meilleure qui puisse arriver, non pas à nous, mais au monde. Sommes-nous sacrifiés au profit d’un calcul
qui nous dépasse ? Est-ce vraiment une réponse qui pourrait nous
satisfaire ? C’est pourquoi Voltaire peut avec son ironie cruelle et
efficace ridiculiser la philosophie de Leibniz dans son personnage de Pangloss.
Enfin,
ce n’est pas parce que le monde est le meilleur des mondes possibles que nous
devons avoir confiance en Dieu. Nous avons plutôt confiance en Dieu en raison
de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Aucun raisonnement ne
peut la justifier complètement, même si elle ne peut non plus s’y opposer. …
Notes
et références
[1] Diderot, Essai
sur le mérite et la vertu, Livre premier, partie première, section
première dans Œuvre de Denis Diderot, volume 1, Belin, 1888,
A. Belin. Il s’agit de la traduction par Diderot de Principe de la
philosophie morale ou Essai de M. S. sur le mérite et
la vertu de Shaftesbury. Cette traduction exprime davantage la
position du traducteur que celle de l’auteur en s’appuyant sur l’autorité de
celui qu’il traduit. « On n’a jamais usé du bien d’autrui avec autant
de liberté », écrit-il lui-même. Voir Discours préliminaire,
dans Œuvres complètes, Diderot, tome I.
[2] Diderot, Essai
sur le mérite et la vertu, Livre premier, partie première, section
première.
[3] Voir Émeraude,
février 2022, article "La Providence divine et le désastre de Lisbonne au XVIIIe siècle".
[4] Leibniz, Essai de
théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal,
Préface, Tome 1, 1731, Gallica.
[5] Bayle, Dictionnaire
historique et critique, article « Pauliciens »,
F, 11ème édition, 1920.
[6] Bayle, Dictionnaire
historique et critique, article « Pauliciens »,
F, 11ème édition, 1920.
[7] Bayle, Pensées
diverses sur la comète,
[8] Bayle, Dictionnaire
historique et critique, article « Pauliciens », E, 11ème édition,
1820.
[9] Bayle, Réponse aux
Question d’un Provincial, LXXI, 663d.
[10] Leibniz, Essais sur
la théodicée, dans Œuvres de Leibniz, volume 2,
Charpentier, 1942, p. 294.
[11] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°2.
[12] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°3.
[13] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°3.
[14] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°6.
[15] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°7.
[16] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°7.
[17] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°7.
[18] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°13.
[19] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°7.
[20] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°23.
[21] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°24.
[22] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°25.
[23] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°25.
[24] Leibniz, Essais sur
la théodicée, 1ère partie, n°47.