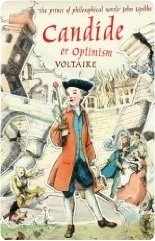Ô
de tous les mortels assemblage effroyable !
D’inutiles
douleurs, éternel entretien !
Philosophes
trompés qui criez : « Tout est bien » ;
Accourez,
contemplez ces ruines affreuses,
Ces
débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,
Ces
femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres
dispersés ;
Cent
mille infortunés que la terre dévore,
Qui,
sanglants, déchirés, et palpitants encore,
Enterrés
sous leurs toits, terminent sans secours
Dans
l’horreur des tourments leurs lamentables jours ! »[1]
Voltaire (1692-1778) pleure
sur les victimes du tremblement de terre qui a ravagé la ville prestigieuse de
Lisbonne dans la matinée du 1er novembre 1755. Le désastre a frappé,
par son ampleur et sa brutalité, toute l’Europe, y compris les intellectuels, les
philosophes et les religieux au point de rester dans la mémoire collective un événement historique majeure dans
l’histoire. Sa notoriété est telle qu’il demeure encore une référence de
nos jours comme l’attestent les événements qui se sont déroulés lors de
l’anniversaire du désastre en 2005 et les nombreux articles qui sont encore
publiés sur ce sujet.
Le
séisme et ses effets funestes n’ont guère laissé indifférents les consciences. Ils
ont détruit beaucoup de certitudes, notamment philosophiques et religieuses, et
provoqué de nombreuses réactions. Le tremblement de terre n’a pas seulement
détruit une ville. Selon de nombreux commentateurs, il a remis en cause des doctrines et une manière de voir les choses.
Comme tout autre désastre, il fait renaître d’une manière effroyable la réalité
du mal au point de remettre en question l’existence d’un Dieu bon et juste mais
également les pensées optimistes d’un certain humanisme. En plein siècle des
Lumières, et plus que tout autre cataclysme, le tremblement de terre de
Lisbonne a « définitivement troublé
le monde de la pensée. »[2]
Lisbonne
ravagée
Le
1er novembre 1755, jour de la fête de la Toussaint, la population se presse
pour assister aux messes et participer aux processions. Et vers 9h40, en plein
office religieux, « un rugissement
effrayant », venu de l’intérieur de la terre, se fait tout-à-coup entendre.
Soudain la terre se met à trembler violemment. Des églises, des palais, des
hôpitaux et des maisons vacillent puis s’effondrent. Le sol s’entrouvre. Puis des
feux se déclarent et d’énormes flammes ravagent les rues et les habitations. La
panique est générale. Nombreux sont alors ceux qui se ruent instinctivement vers
le port et les navires plus sûrs semble-t-il, mais là, encore impuissante, la
foule assiste à un étrange phénomène. La mer recule sur de longs kilomètres
puis s’élève en une énorme vague pour s’abattre ensuite sur les bateaux et les
quais, ne laissant guère de chance aux survivants. Tous les éléments naturels,
terre, feu et eaux se mettent ainsi à frapper d’une violence inouïe la ville
livrée à elle-même. C’est le chaos indescriptible. D’autres secousses se font encore
sentir. Les bâtiments qui restent encore debout finissent par s’effondrer
« avec un fracas épouvantable ».
Le bilan est effroyable. Si le nombre de morts est difficile à estimer, les études actuelles évaluent à dizaines de
milliers de morts[3].
Le séisme a aussi touché d’autres villes que Lisbonne, par exemple Cadix et au
Maroc.
Le
déiste Voltaire
La
catastrophe déclenche dans l’œuvre de Voltaire deux réactions, l’une immédiate
par le Poème sur le désastre de Lisbonne, fin novembre 1755, l’autre
plus tardive, dans Candide, rédigé en 1758.
Rappelons
que Voltaire est un déiste. Il croit
en un Être suprême aussi bon que puissant, créateur de toute chose, punissant
les crimes et récompensant les actions vertueuses. Il croit donc en un ordre du monde que Dieu a conçu et qu’Il
maintient pour le bien de tous, donnant finalement le monde le plus parfait.
Une telle conception de Dieu et du monde, que défend par ailleurs d’autres
philosophes comme le poète anglais Alexander
Pope (1688-1744) et Leibniz
(1646-1716), est alors une grande source d’optimisme
au XVIIIe siècle. C’est pourquoi, en 1732, Voltaire adresse à Pascal et à
son pessimisme de vigoureuses critiques dans ses Remarques sur Pascal.
Ainsi,
pour les philosophes des Lumières, tout
est bien en ce monde. Cependant, peu à peu, Voltaire reconnait que
l’existence du mal remet en question ce principe tant exclamé. Le désastre de
Lisbonne en est une remise en cause encore plus frappant.
L’optimisme
des Lumières
 |
| Alexander Pope |
Leibniz
considère davantage le mal moral, dont la source est le péché originel. Le
monde est pour lui le plus parfait
puisqu’il a donné lieu à l’œuvre de la rédemption et de la grâce. De plus, il
est convaincu que Dieu agit toujours par des lois générales, et non par des
décisions particulières. Et la compréhension de la rationalité du monde, qui se
manifeste notamment par ses lois, nous permet de contribuer à la gloire de Dieu.
Des « philosophes
trompés »
Pope
et Leibniz sont sans-doute les « philosophes
trompés » qu’apostrophe Voltaire. Comme le soulignent le titre puis
quelques versets ironiques, son poème ne serait pas compréhensible si nous le
réduisons à une lamentation ou à une touchante compassion. Il a été écrit pour s’attaquer à l’optimisme d’une certaine
conception du monde, notamment aux idées de Pope et de Leibnitz. Ce dernier
est même cité. « C’est l’effet des
éternelles lois qui d’un Dieu libre et bon nécessitant le choix ? ». « C’est l’orgueil, dites-vous, l’orgueil
séditieux, qui prétend qu’étant mal, nous pouvions être mieux. » Sa
conclusion est évidente : « Tout
est bien aujourd’hui, voilà l’illusion. »
Le principe du déisme
fait aussi l’objet de reproches. « Ces
immuables lois de la nécessité, cette chaîne des corps, des esprits et des
mondes. Ô rêves des savants ! Ô chimères profondes ! Dieu tient en
main la chaîne, et n’est point enchaîné. Par son choix bienfaisant tout est
déterminé : Il est libre, il est juste, il n’est point implacable.
Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable.»
Le
poème s’en prend aussi à d’autres explications rationnelles du mal, en
particulier à celles de la justice
divine. Le mal ne serait que la punition d’un mal commis ? Pourtant,
« l’innocent ainsi que le coupable
subit également ce mal inévitable ». Il apporterait un plus grand
bien ? « Ce malheur,
dites-vous, est le bien d’un autre être. De mon corps tout sanglant mille
insecte vont naître ; quand la mort met le comble aux maux que j’ai
soufferts, le beau soulagement d’être mangés des vers ! »
Face
à tout raisonnement, Voltaire dresse notre
sensibilité. « Quand
l’homme ose gémir d’un fléau si terrible, il n’est pas orgueilleux, hélas, il
est sensible ! » La nature humaine ne peut que se révolter devant
tant de malheurs. C’est même physique.
« Et le sentiment prompt de ses
nerfs délicats fut soumis aux douleurs sinistres du trépas. C’est là que
m’apprend la voix de le Nature. »
L’impuissance
de la philosophie face à la réalité du mal
Voltaire réaffirme fortement l’existence
du problème et rappellent ses données que les philosophes ne parviennent pas à
résoudre, lui non plus. « Je
suis comme un docteur ; hélas ! je ne sais rien. » Son poème
n’apporte en effet guère de solution. Pourtant, nous pourrions croire que
Voltaire nous en apporte en une, l’espérance, qui achève majestueusement ses
vers. Il s’agit de ne pas s’arrêter au présent mais de porter son regard sur
l’avenir. « Un jour tout sera bien,
voilà notre espérance. » Et pourtant, ce mot ultime ne doit pas
nous faire oublier une certaine imposture ou diplomatie de la part du grand
polémiste. Dans la version non publiée du poème, la fin est davantage plus
pessimiste et moins religieux. Bien qu’il affirme à nombreuses reprises son
respect pour Dieu et la Providence, ses vers ne nous trompent guère.
Voltaire
se moque de ces deux personnages aux convictions si opposées, qui, en dépit des
épreuves, ne changeront pas de position. Il
se moque de l’impuissance de la philosophie face à la réalité du mal, même
s’il philosophe aussi dans son récit imaginaire. Il décrit finalement un monde
irrémédiablement mauvais, injuste et stupide, dans lequel nous devons nous contenter de prendre soin de notre
petit jardin discrètement, ne travaillant que pour subvenir à nos besoins. Si la pensée ne peut rien contre le mal,
devons-nous encore penser le monde ?
Contre
la superstition
L’évocation
du tremblement de terre de Lisbonne dans Candide est aussi un moyen de
ridiculiser et de critiquer l’Église comme le sait si bien faire Voltaire. « Après le tremblement de terre qui avait
détruit les trois quart de Lisbonne, les sages du pays n’avaient pas trouvé un
moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale, que de donner au peuple un
bel autodafé. » Ces « sages »,
c’est-à-dire les inquisiteurs, cherchent en fait à apaiser l’inquiétude et les
craintes de la population. Des boucs-émissaires sont aussi trouvés. Des
chrétiens « qui n’avaient point
mangé de lard », c’est-à-dire des faux convertis du judaïsme, « furent brûlés » Et malgré cela,
« la terre trembla de nouveau avec
un fracas épouvantable. » En fait, pour Voltaire, ceux qui professent
une telle thèse ne font que distraire les craintes de la population par la
superstition. Le philosophe accuse l’Église d’user d’une puissance politique
qui ne relève pas de ses compétences.
Une
vengeance divine ?
Mais
comme Kant (1724-1804) nous le rappelle, « ce serait une grave erreur de toujours regarder de semblables destins
comme une punition qui serait infligée aux cités dévastées, en raison de leurs
crimes, et de considérer comme l’objet de la vengeance de Dieu ces infortunés
sur lesquels s’exercerait la colère de sa justice. Cette sorte d’opinion est
d’une condamnable impertinence, qui présume de sonder les desseins des décrets
divins et de les interpréter d’après son jugement personnel. »[6]
Kant
explique cette « grave erreur »
par la peur qui dérobe à l’homme son
jugement et par son orgueil.
L’homme « se croit être dans sa totalité […] le digne objet de la sagesse divine et de
ses institutions »[7],
et prétend même entrer dans le conseil de Dieu. « Nous en sommes une partie et nous voulons être un tout. On ne considère
pas les règles de la perfection de la nature dans son ensemble, et l’on croit
que tout devrait être purement et simplement en relation de convenance avec
nous. »[8]
Et dans la correspondance de Voltaire ?
Dans
ses correspondances, Voltaire réagit aussi au désastre de Lisbonne qu’il
considère comme « un terrible
argument contre l’optimisme »[9].
Dans une lettre à M. Tronchin, éditeur lyonnais, il ironise sur l’optimisme des
philosophes qui seraient « bien
embarrassés à deviner comment les lois du mouvement opèrent des désastres si
effroyables dans le meilleur des mondes possibles »[10].
Dans une autre[11],
il souligne que le désastre de Lisbonne est suffisamment sérieux pour faire
taire l’optimisme des Lumières, citant l’un des philosophes partisans : « Si Pope avait été à Lisbonne, aurait-il osé
dire : Tut est bien ? » Il souligne la fragilité humaine.
« Quel triste jeu de hasard que le jeu
de la vie humaine ! » 12]
Il se satisfait néanmoins que les mauvais, c’est-à-dire les « inquisiteurs », soient aussi
victimes du drame.
Dans
une lettre qu’il adresse à la duchesse de Saxe-Gotha, Voltaire s’oppose à ceux
qui croient que « le mal moral
serait bien au-dessus du mal physique, et ce serait bien pis qu’un tremblement
de terre. »[13]
Enfin,
le pessimisme de Voltaire est bien plus affirmé dans ses lettres que dans
Candide et son poème. Vivre consiste pour lui désormais à « tirer parti de cette courte et misérable vie »[14].
La
réponse de Rousseau
Pour
Rousseau, la plupart de nos maux physique est l’ouvrage de l’homme. Le séisme de Lisbonne aurait en effet fait
moins de morts et de dégâts si les hommes ne s’étaient pas aussi concentrés
dans un espace si restreint, habitant dans des logements aux nombreux étages.
La panique qui a résulté du tremblement de terre ou encore la volonté de sauver
leur richesse ont aussi fait de nombreuses victimes. Par conséquent, le mal physique se fonde sur des maux
moraux liés aux progrès, à la cupidité ou à bien d’autres vices.
Enfin,
Rousseau traite de la perception du mal.
« Il y a des événements qui nous
frappent plus ou moins selon les faces par lesquelles on les considère, et qui
perdent beaucoup d’horreur qu’ils inspirent au premier aspect. »[16]
Un mal peut ainsi éviter de plus grands maux. Il s’agit de placer l’événement
perçu comme un mal dans le système
dans lequel il appartient, non à un instant, mais dans le temps. Et ramenée à la vérité de l’immortalité de l’âme,
qu’est-ce qu’une vie humaine ici-bas ? Finalement, « tout est bien pour le tout ».
La
réponse de Kant
De
même, rompant avec ses contemporains,
il évite dans ses écrits le pathétique et les discours alarmants. Il se détache ainsi de toute sensiblerie pour
se consacrer à l’étude. C’est pourquoi il ne s’intéresse pas uniquement au
tremblement de terre de Lisbonne mais au séisme de manière général, ne le
prenant que comme exemple, pour éviter de s’enfermer dans un cas particulier.
Comme
Rousseau, il évoque l’hypothèse d’une aggravation du drame en raison de l’homme
par la localisation de la ville et demande qu’« aucune ville située dans une région ayant connu plusieurs fois de
tremblements de terre dont la direction peut être déduite grâce à l’expérience,
ne devrait être édifiée dans une direction parallèle à celle qu’emprunte les
séismes. »[18]
Pour se prémunir de tels maux physiques,
l’homme doit mieux connaître les phénomènes naturels.
Cependant,
Kant n’oublie pas que dans tout mal
physique, l’homme peut retirer un bien. « Quels que soient les dommages occasionnés aux hommes à cause des
tremblements de terre, cela peut facilement être compensé, avec usure, d’un
autre côté. »[19]
Conclusions
Comme
l’attestent Voltaire et bien d’autres contemporains du tremblement de terre de
Lisbonne, le drame que la ville prestigieuse a subi provoque naturellement une
vive émotion et une profonde compassion en Europe à l’égard de toutes les
victimes. Par notre nature sensible,
nous ne pouvons pas en effet rester indifférents à l’égard de tant de douleurs
et de souffrances. Tout raisonnement qui justifierait le cataclysme et ses
effets terribles, même les plus justes, n’est alors guère audible pour tous
ceux qui l’ont vécu et qui ont tant de mal à panser leurs plaies. Il y a un temps pour réfléchir comme il y a un temps pour pleurer, un temps pour consoler. Il est donc
vain de vouloir donner du sens à l’événement quand le souvenir du drame est si
pesant puisqu’aucune parole rationnelle ne peut être entendue. Cependant,
contrairement à Voltaire, qui philosophe lui-même, cela ne signifie pas que la
raison est impuissante à surmonter l’épreuve. Car finalement, l’homme a besoin de donner du sens à sa vie et plus particulièrement dans
ses épreuves les plus difficiles. Il ne peut ne pas y réfléchir…
En
cherchant à justifier ce qui paraît inacceptable, nous risquons aussi de voir notre jugement aveuglé par notre nature
sensible et de nous égarer dans des
explications erronées ou exagérées.
Nous sommes alors parfois tentés de voir uniquement le mal dans l’existence
humaine et nous perdre alors dans un pessimisme outré au point de nous replier sur nous-mêmes. Notre
regard n’est finalement porté que sur nous-mêmes au point d’oublier de prendre
de la hauteur et de considérer l’événement à
sa juste valeur. Nous pourrons ainsi nous apercevoir que les maux subis ou
du moins leur aggravation ne sont qu’une conséquence de négligence ou d’insouciance
humaines, voire de vices. Dieu fera-t-Il
changer ses lois pour pallier à nos faiblesses et nos suffisances ? Notre
planète serait alors ingouvernable… Comme il pleut sur les bons et les mauvais,
les phénomènes naturels n’épargnent pas non plus ses fidèles.
Dans
notre égarement, penserions-nous peut-être que la calamité est un fléau divin,
justement mérité pour nos péchés comme si nous étions capables par nous-mêmes
de deviner les desseins de Dieu ?
Si le Tout-Puissant ne nous révèle pas ses intentions, qui saura les
percevoir ? « Ô homme, qui
es-tu pour contester avec Dieu ? »(Épître aux Romains, IX,
17) Le drame éveille en nous toutes nos
faiblesses et nos erreurs, notre petitesse et nos vanités. Qui sommes-nous
en effet pour croire que Dieu nous laisserait en dehors de ses lois ? Nous
prenons ainsi conscience de notre nature de créature et par conséquent limitée et vulnérable, et notre âme ne
peut que revenir à Dieu, louant davantage sa miséricorde. Ce juste retour est
un des plus grands biens que nous pouvons retirer du mal.
Il
existe beaucoup d’autres biens qui attendent les survivants et les témoins du
drame. Le soin des blessés et des âmes, l’enterrement des morts et la
reconstruction de la ville détruite en sont des exemples. La recherche
d’explications scientifiques pour prémunir de tels dangers et éviter que
l’homme y aggrave les conséquences en sont d’autres. Nous nous rendons alors compte
par là que les souffrances ne sont pas
vaines ou que les maux physiques
n’ont pas le dernier mot. Comme notre vie n’est pas à l’abri d’épreuves et
d’infortunes, de pleurs et de larmes, en raison même de notre nature, et
qu’elle est destinée à s’achever ici-bas, aujourd’hui ou dans trente ans, le
plus important n’est pas de recevoir des coups mais de les surmonter en restant fidèle à Dieu et de profiter de nos maux pour grandir dans son amour. L’important n’est
donc pas de deviner la volonté de Dieu mais de vivre selon sa volonté. Face à
la désolation, c’est notre réaction qui importe le plus, et nos pensées vaines.
C’est dans les circonstances les plus durs que notre amour à son égard se
révèle comme le montre l’exemple de Job. L’éternité est à ce prix…
Notes et références
[1]
Voltaire, Poème sur le Désastre de Lisbonne, ou examen de cet
axiome Tout est Bien, dans Œuvres complètes de Voltaire,
Garbier, 1877, tome 9, Wikisource.
[2]
Olinda Kleiman, Le désastre de Lisbonne, un teras, En guise d’introduction du
dossier Le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, Perceptions d’un événement,
sous la coordination d’Olinda Kleiman, Philippe Rousseau, André Belo, Atlante,
n° 1, automne 2014, Université Lille 3, Laboratoire CECILLE, atlante.univ-lille.fr.
Le dossier résulte des journées d’étude tenues à l’Université de Lille les 24
et 25 novembre 2005 pour commémorer le 250ème anniversaire de la
catastrophe.
[3]
10 000 est le chiffre estimé des morts par Jean-Pierre Poirier dans Le
tremblement de Terre de Lisbonne, Odile Jacob, 2005. Selon une étude de
Jean-Marc Rohrbasser (Le tremblement de terre de Lisbonne :
un mal pour un bien ?, Annales de démographie historique,
2012, n°), il serait de 74 000, évalué à
partir du nombre de feux et d’âmes dans les paroisses touchées avant et après
1755. Au XVIIIe siècle, le nombre de morts était évalué à 100 000.
[4]
Voir Jugement
sur la cause véritable du tremblement de terre qui advint à Lisbonne le premier
novembre 1755, Gabriel Malagrida, 1756. Le père jésuite est livré en
1759à l’Inquisition par le ministre Caravalho comme « faux prophète et faux dévot ». Il est étranglé puis brûlé lors
d’un autodafé en 1760 sur ordre de ce ministre, grand défenseur des Lumières.
[5]
Voir en particulier le méthodiste Wesley qui met en garde les impies qui
pensent que les tremblements de terre ont une cause naturelle. Voir Sérieuses
pensées occasionnées par le tremblement de terre à Lisbonne, Wesley,
publié en 1756.
[6]
Kant, Histoire et description des plus remarquables événements relatifs au
tremblement de terre qui a secoué une grande partie de la terre à la fin de
l’année 1755, trad. de J.-P. Poirier, dans Cahiers philosophiques,
1999.
[7]
Kant, Histoire et description des plus remarquables événements relatifs au
tremblement de terre qui a secoué une grande partie de la terre à la fin de
l’année 1755.
[8]
Kant, Histoire et description des plus remarquables événements relatifs au
tremblement de terre qui a secoué une grande partie de la terre à la fin de
l’année 1755.
[9]
Voltaire, À M. Bertrand, de Lyon, lettre n°3069, Aux délices le 30
novembre 1755, dans Voltaire, Correspondance : année 1755, Œuvres
complètes de Voltaire, tome 38, Garnier, 1877.
[10]
Voltaire, À M. Tronchin, de Lyon, lettre n°3065, Aux délices le 24
novembre 1755, dans Voltaire, Correspondance : année 1755, Œuvres
complètes de Voltaire, tome 38.
[11]
Voltaire, À M. Bertrand, Aux Délices, 28 novembre 1755, lettre n°3067, ,
dans Voltaire, Correspondance : année 1755. M. Bertrand est un pasteur de
l’église française à Berne, ami de Voltaire.
[12]
Voltaire, À M. Tronchin, de Lyon, lettre n°3065, aux Délices, 24 novembre
1755, dans Voltaire, Correspondance : année 1755, Œuvres
complètes de Voltaire, tome 38.
[13]
Voltaire, À Madame la duchesse de Saxe-Gotha, Aux Délices, près de Genève,
9 mars 1776, lettre n°3130, dans Voltaire, Correspondance : année 1756,
Œuvres
complètes de Voltaire, tome 39.
[14]
Voltaire, À M. le comte d’Argental, lettre n°3069, Aux Délices, le 1er
décembre 1875.
[15]
Rousseau, Lettre à M. Voltaire, le 18 août 1756, dans Lettres
sur divers sujets de philosophie, de moral et de politique, dans Collection
complète des œuvres de J.-J. Rousseau, tome 12, 1782.
[16]
Rousseau, Lettre à M. Voltaire, le 18 août 1756, dans Lettres
sur divers sujets de philosophie, de moral et de politique, dans Collection
complète des œuvres de J.-J. Rousseau, tome 12.
[17]
Kant, Histoire et description des plus remarquables événements relatifs au
tremblement de terre qui a secoué une grande partie de la terre à la fin de
l’année 1755.
[18]
Kant, Sur les causes des tremblements de terre, à l’occasion du désastre qui
a frappé les contrées occidentales de l’Europe, à la fin de l’année dernière,
traduction de l’allemand par Elise Lanoë, Université Lille 3, Deux
écrits de Kant dans Atlante, n° 1.
[19]
Kant, Histoire et description des plus remarquables événements relatifs au
tremblement de terre qui a secoué une grande partie de la terre à la fin de
l’année 1755, traduction de J.-P. Poirier, Cahier philosophique,
n°78, mars 1999 dans Atlante, n° 1.